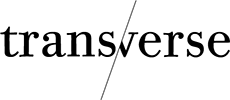Suture, 2012. Intervention corporelle en extérieur à Saint-Pétersbourg, événement, photographie courtesy Editions Exils, France, 2020
Théorème Piotr Pavlenski, le livre que Mariel Primois Bizot consacre au jeune artiste russe Piotr Pavlenski repose sur une suite d’entretiens au cours desquels l’artiste déroule, comme l’indique le titre, une suite de propositions pour penser la relation art -politique. La question est toujours d’actualité même si en période post-moderne les paramètres ont changé. Grâce à des extraits choisis dans le livre, suivons ce nouveau raisonnement au travers des mots de Pavlenski à propos de sa première œuvre Suture.
(...)«Suture est né du soutien aux membres du collectif Pussy Riot, alors en procès pour avoir chanté une « prière punk » dans la cathédrale du Christ-Sauveur de Moscou – ce qui à mes yeux était une transposition de l’acte de Jésus chassant les marchands du temple. J’y ai vu un puissant geste artistique. Mais dans les académies d’art où j’étudiais durant cette année 2012, personne n’en parlait ou alors en parlait en mal – même parmi les élèves !
Dans un premier temps, j’ai imaginé manifester seul. Me tenir en piquet solitaire, ce qui est une tradition russe. Les regroupements de manifestants restant souvent interdits, une personne se tient immobile dans la rue, à un endroit précis, une pancarte dans les mains ou autour du cou. Je n’avais jamais fait ça. J’en ai parlé à une amie, militante activiste qui avait une grande expérience de la contestation. Elle m’a dit : « Tu dois te préparer à être arrêté et placé en garde à vue. » J’ai commencé à envisager la chose, mais l’idée de devoir expliquer mon geste à des policiers m’a aussitôt horrifié. Pourquoi faudrait-il que je me justifie de quoi que ce soit ? Le slogan de ma pancarte ne suffit-il pas à tout dire de mes intentions ?
J’ai finalement décidé de me tenir debout, à midi, devant la cathédrale Notre-Dame-de-Kazan, à Saint-Pétersbourg, les lèvres cousues avec du fil rouge. C’est ainsi qu’est apparue, sous cette forme étrange, mon premier événement.
À l’époque, je ne pensais pas encore faire un événement d’Art politique. À quoi pensais-je ? Qu’en cousant ma bouche, la police ne pourrait obtenir aucun témoignage, aucune explication – d’ailleurs, le pouvoir n’essaie-t-il pas éternellement d’obtenir de nous que nous fermions notre gueule et que nous ne parlions pas de l’oppression qu’il nous fait subir ? Avec Suture, je poussais donc le désir du pouvoir à son achèvement logique. Et, c’est une évidence, cela est suffisant pour le conduire dans une impasse.
(...) Suture condensait en fait des années de réflexion. (...) Comme dans le film 71 Fragments d’une chronologie du hasard, de Michael Haneke, Suture était une mosaïque, une accumulation de fragments du réel auquel l’existence m’avait confronté. Plus tard, j’ai analysé ce qui c’était réellement passé…
Sur le moment, mon événement n’était qu’une pure réaction d’indignation. Ce n’était pas mon intellect froid qui me guidait mais ma sensibilité qui avait débordé et rendait impossible pour moi de rester indifférent face à l’injustice qui frappait les Pussy Riot. Une pression était montée en moi et m’avait envahi. C’était vital : soit je faisais quelque chose, soit j’acceptais de prendre place parmi les morts-vivants. Suture fut ma réponse à l’oppression et même à tout le système. Mais, ce faisant, à ma propre surprise, elle répondait surtout à l’immense question : « Qui est artiste et qui ne l’est pas ? » Avec cet événement, j’avais trouvé ma forme d’expression, expérimenté la force de l’art et ressenti sa puissance que je maîtrisais enfin. Je venais de vivre un événement qui me faisait basculer dans l’art. C’était la première fois.
Suture m’offrait un point de comparaison, un avant/après, sans marche arrière possible, ouvrant devant moi les portes d’une libération : la possibilité du choix. À travers ce premier événement, l’art et la société étaient entrés en dialogue dans ma vie. Soudainement, cet échange, qui est la base même de l’art, la condition sine qua non de son existence, avait surgi. Je m’exprimais et la société me répondait.
Ce dialogue n’était pas une conversation mais une dispute. Mais peu importait. Un affrontement avait eu lieu, où les adversaires aux visions opposées s’étaient livré bataille, arguments contre arguments. J’étais heureux, je sortais de l’hypocrisie, laissant derrière moi les vieux oripeaux d’un système qui m’avait contraint pendant des années. Et l’étau des institutions – de toutes les institutions, avait disparu, pulvérisé.
L’année qui suivit Suture fut compliquée. Je sortais tout juste de dix ans d’une éducation artistique conforme, où l’on m’avait enseigné comment travailler, comment séduire pour parvenir à monter une exposition, comment constituer un réseau, etc. et voilà qu’au cours de la dernière année, celle du diplôme, je venais de poser Suture.
Les gens du milieu de l’art, les professeurs et les autres étudiants ne m’ont pas rejeté immédiatement. Ils m’ont fait comprendre que je pouvais revenir dans le système, si je voulais. Ils étaient d’accord pour m’accepter, me pardonner en quelque sorte, d’un délire qui m’avait traversé un bref instant. Dans un premier temps, je me suis efforcé de croire à leur sincérité. Mais ça n’a pas duré longtemps. Je ne pouvais plus. La fiction dans laquelle ils évoluaient m’écoeurait trop. Je ne pouvais réellement plus ! (...)
(…) Pour Suture, j’avais invité beaucoup de photographes, mais la plupart s’étaient désistés. Par peur sans doute, craignant la réaction de la police et le risque d’un dérapage de la situation. Plusieurs avaient tout de même osé venir mais, dans l’ensemble, leurs images ne valaient rien… Surtout comparées à celles d’un certain Martin Zmeyev...
(…) Suture ou Fixation sont des « événements d’art politique », en ce qu’ils forcent les appareils du pouvoir à produire des dispositifs, constitués de toutes leurs actions, rapports, expertises, photos, films, jugements et punitions, confectionnés par eux-mêmes, sans ma participation, dans leurs tentatives d’étouffement et d’écrasement de l’événement. Tous ces représentants du pouvoir, que ce soit les policiers, les médecins, les psychiatres ou les juges, vont prendre en main mon « affaire » et se prendre les pieds dedans comme dans une toile d’araignée puisque c’est leur pouvoir même qui les implique dans cette « affaire » et les transforme en objet de mon événement.(...)
Dans mon aspiration à devenir un os qui restera en travers de la gorge de l’insatiable appareil, je reste imperturbable quand on me cherche des noises administratives ou que l’on m’intente un procès. L’artiste ne pourra agir au coeur de la mécanique du pouvoir que s’il trouve la force de ne pas chier dans son froc à la première assignation en justice ou en voyant le premier mandat de dépôt à son encontre. C’est justement le rejet de ces phobies imposées par le pouvoir qui devient le principe indispensable sans lequel le processus de l’art politique ne pourrait pas commencer.
(…) Ne jamais répondre aux questions du pouvoir est donc un principe crucial de l’Art politique. C’est le « règlement du silence », que j’applique lors de mes événements – lors de Suture, par définition, mais aussi de Carcasse et de toutes les autres. En déclarant d’emblée que je vais garder le silence au tribunal, j’agis sur le juge. C’est une action conjointe : ma posture brise la routine quotidienne de la procédure judiciaire et modifie ipso facto le caractère de mon dossier. L’inquiétude force le juge à réfléchir comme chaque fois que les autorités sont confrontées à des situations atypiques, sortant du cadre habituel de leurs fonctions. La police, est également obligée de réfléchir.
(…) Mes relations avec la psychiatrie ont débuté en 2012, le jour où, debout, avec ma bouche cousue de fil rouge devant la cathédrale Notre-Dame-de-Kazan, à Saint-Pétersbourg, je fixais l’horizon. Par ce silence, cette non-action, je plongeais les forces de l’ordre dans la panique. Que pouvait-ils faire ? M’arrêter, comme ça ? Bloqués, impuissants, la moindre décision pouvait les entraîner hors des cadres de la loi, et ça, ils ne le peuvent pas. Leur pouvoir ne leur laissant pas la liberté de réfléchir, de décider, ma non-action révélait leurs limites, redéfinissait l’étroitesse de leur champ d’action et anéantissait leur pouvoir.
Pourtant, ils ne pouvaient laisser errer un individu avec la bouche cousue dans l’espace public. Que s’est-il alors passé ? Lorsqu’un policier ne peut rien, la mécanique du pouvoir ayant bien évidement prévu ce cas de figure, les articles de la loi lui suggèrent de faire appel à cet autre technicien du maintien de l’ordre qu’est le médecin. Ce dernier prenant le relais de la police, lorsque l’ambulance est arrivée, j’ai immédiatement senti la police soulagée.
Les diables et autres esprits malins sont morts mais leur mort a laissé la place à une entité, encore plus vorace, qui sert avec avidité la lettre de la loi : la maladie mentale. La psychiatrie, en tant qu’institution, est un appareil d’exclusion que la société ne pourra pas abolir tant qu’elle ne se sera pas débarrassée de la foi en ce nouveau démon, tant que son ombre nous surplombe. Chacun peut avoir besoin de l’aide d’un psychiatre, mais la psychiatrie n’est pas là pour aider l’humanité : elle est l’instrument de la ségrégation. Comment le psychiatre pratique-t-il cette ségrégation ? Il protège l’opinion publique contre tout ce qui pourrait troubler, même très légèrement, son calme monolithique. Une expertise psychiatrique médico-légale offre au pouvoir des arguments commodes lorsqu’il a besoin d’éliminer, de façon légale, des écarts enfreignant l’ordre établi mais échappant aux grilles pénales habituelles. L’expertise établit une non-conformité sociale – une maladie qui exige une mise à l’isolement et une correction médicale.
Arrivé à l’hôpital, la première personne que j’ai vue était une femme psychiatre qui d’entrée a tenu à marquer son pouvoir en congédiant fermement les policiers. Une fois débarrassée des forces de l’ordre, elle m’a demandé : « Pourquoi as-tu fait ça ? » et a ajouté : « C’est politique, c’est ça ? Tu as fait ça en soutien aux Pussy Riot ? » Puis, elle a fait venir l’infirmier, qui a coupé les fils de ma bouche, et nous avons discuté. « Je ne peux pas dire ce que je pense de cette répression, je dois conserver mon poste ici, mais si je pouvais… »
Il pleuvait ce jour-là et nous sommes partis ensemble, sous son parapluie, jusqu’à l’arrêt du bus. J’étais libre, elle venait de remplir la fiche de son diagnostic où elle avait écrit : « Plaie pénétrante des lèvres supérieure et inférieure. » Avec en conclusion : « Psychiquement en bonne santé. » Ce jour-là, c’est un regard de psychiatre qui m’a soutenu ; son avis est devenu mon diagnostic. C’était un jour de chance. Les autres médecins que j’ai croisés par la suite n’ont pas été aussi intelligents. (...)
L’art politique est un art visuel. Il rend visible, tout simplement. Ce que, pour ma part, je conçois comme le but du seul art qui m’intéresse est de rendre visible la mécanique du pouvoir. Mon objet est de la révéler, comme l’a fait l’art depuis le début de son histoire. Ce que je veux faire – et parfois j’y parviens –, c’est détruire le décor qui cache cette mécanique. L’ensemble de mon activité artistique est consacré au rapport sujet/objet. Ce qui m’intéresse est de retourner, de modifier, d’inverser la disposition des relations sujet/objet. C’est la ligne sur laquelle se trouve tout ce que je fais, l’essence de mes créations. Depuis Suture jusque récemment Pornopolitique, la forme de ce que je fais peut changer, mais le sens reste le même.
Mon art consiste à construire des circonstances qui mettent en lumière les appareils du pouvoir. La politique s’inscrit dans la mécanique du pouvoir. Mon art ne parle pas de politique mais de la mécanique du pouvoir. » (...) »
**************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
Piotr Pavlenski en arrivant en France, en 2017, nourrissait-il quelques espoirs envers le pays de 1789 et du marquis de Sade ? Il a pu y mesurer la confusion actuelle dans des valeurs pourtant établies et affichées. Au départ il y eut sans doute un quiproquo : l’Occident n’était pas prêt à accepter d’être maltraité par un réfugié politique à qui il avait ouvert les bras. Il devra changer, Pavlenski n’a que faire de la reconnaissance. Il n’a pas l’intention de s’insérer dans le troupeau. Il attaque tout de suite, et ses actions artistiques frontales déclenchent autant d’indignation, et de répression qu’en Russie. Mais pas pour les mêmes raisons car les causes de l’indignation sont finalement fluctuantes. Au final il sera incarcéré plus d’un an et est maintenant en procès pour son action Pornopolitique qui a fait tomber un député candidat à la mairie de Paris.
Un siècle nous sépare de la tonitruante énergie de Dada Berlin qui mettait l’artiste à l’ouvrage d’un grand changement sociétal. L’idée a traversé le siècle, a été portée par les avant-garde constructivistes, cubistes, surréalistes, situationnistes, punks, activist. Le bilan ? Beaucoup trop de contradictions internes, pour qu’une telle stratégie puisse aboutir. Actuellement, dans le duo art et combat politique, la démarcation entre les bons et les mauvais n’est plus aussi nette. N’a-t-on pas souvent l’impression que les artistes « engagés », porte-voix de grands combats humanitaires, travaillent autant pour leur image que pour rendre un monde meilleur possible ? A fortiori dans notre société d’interactions communicantes permanentes, la problématique art-politique ne peut plus être pensée comme un espoir d’un art déclencheur de la révolution. Pourtant le mythe continue à circuler et alors que le goulag a disparu, le lavage de cerveau, plus ou moins « soft », reste toujours le meilleur moyen de contrôler la société.
On comprend le ressentiment qu’un.e artiste de la génération des années 80 peut nourrir. Pour les enfants désenchantés de la post-modernité tout est bon à déconstruire, y compris le politique et le pouvoir qui l’accompagne, sa forme de gouvernance et d’administration. L’époque est sans pitié pour la sensibilité. Pavlenski dresse le tableau de l’enseignement d’art en Russie. Il commence par décrire une académie où on n’apprend pas à devenir artiste mais à « mettre en image une idéologie ». Relents du communisme sans doute. Il tente alors un enseignement d’art contemporain dans une Fondation. « Là on formait les serviteurs d’une autre espèce, spécialisés dans l’obtention des bourses et de toutes sortes de suvbentions ». Petit à petit il faudra se plier aux standards du politiquement correct. En France ce n’est pas mieux estime-t-il, on y nage en plein « marigot de l’hypocrisie ».
Avec ses mises en scène en tableaux vivants, automartyrisé et surtout imperturbable, Pavlenski dit vouloir briser la routine c’est à dire l’agitation vaine, inquiéter par son silence et finalement faire réfléchir. Il s’autorise les détournements debordiens, réinterprétant des œuvres du passé. Pour Suture il reprend une action de l’artiste américain David Wojnarowicz. Il s’inspire également d’un geste de protestation, une figure violente littérale de l’expression « bouche cousue », qu’accomplissent des milliers de détenus dans les prisons du monde entier (information recueillie lors d'un entretien avec l'artiste). Pavlenski place l’art politique dans une perspective où l‘artiste ne mêne plus le combat collectif mais incarne à lui tout seul la supériorité de l’individu sur la masse anesthésiée. On veut bien le croire... mais on n’est plus si sûr que l’existentialisme soit un humanisme ! Alors y aurait-il chez lui comme chez tous une bonne dose de cynisme narcissique ? On peut aussi aller vers d’autres hypothèses : celle d’un romantisme nihiliste ? Ou au contraire d’une position messianique entraînant l’art vers des lendemains qui chantent ? Mais cela aussi a un air de déjà vu et ce n’est pas son genre. D’ailleurs, jusqu’à présent toutes les révolutions ont échoué ou dépéri.
Pavlenski est-il si loin de la vérité quand il constate que « l’art en tant que tel était dès son origine un instrument du pouvoir » ? Quelle valeurs de l’art fait-il subsister dans ce grand tourbillon ? La consolation du travail bien fait, les récompenses, la virtuosité, le mérite, les bonnes tactiques ? N’est-ce pas pour cela que les critères de consécration se dessinent au final dans la longue durée, à l’épreuve de l’histoire de l’art ?
Remercions Mariel Primois Bizot et Piotr Pavlenski pour nous avoir livré une telle matière à réflexion.
Anne-Marie Morice
Lu dans
Piotr Pavlenski, Théorème
Entretiens avec Mariel Primois Bizot
Editions Exils, France, 2020
Collection Art dirigée par Philippe Thureau Dangin