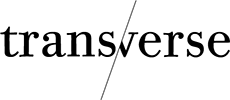The Fiji Times, photographies et images fixes extraites d'une vidéo de 29 mn en HDV.
Dans son dernier travail Olivier Menanteau réalise une oeuvre originale hybride entre cinéma documentaire, oeuvre vidéographique et installation photographique.
Durant trente minutes se déroule devant nos yeux un serpentin entrecoupé de lambeaux historiques à propos de l’Histoire des Fiji, avec des inserts qui nous expliquent certains événements et nous rappellent des dates. Le réalisateur qui se fait commentateur et scénariste, l’équipe technique étant réduite à sa plus simple expression, plein d’humour et de recul sur lui-même et sur ses actes filmiques, sort des eaux le tee-shirt trempé comme Vénus fécondée par Ouranos, pour nous annoncer plus tard qu’un des derniers rois avait mangé huit cent cinquante-trois personnes qui étaient ses ennemis, dernier acte du cannibalisme, qui déclenche notre fou rire à peine refoulé, l’horreur devenant gag anthropologique.
Comme durant cette lecture d’un épisode de 1867 où un missionnaire de l’époque, le révérend Thomas Baker, déclarait « je ne redoute pas les indigènes et nous espérons leur apporter du bien »; la réponse des habitants du village fut de le couper en morceaux à la hache, lui et ses acolytes, et de déclarer, suite à ses propres déclarations : « Nous avons tout mangé à l’exception des bottes ». En effet jusqu’à cette date pas si reculée, l’anthropophagie était naturelle du côté des Fiji, mais convertis à la religion chrétienne, les autochtones ne tardèrent pas à se repentir.
Ce n’est donc pas tant ce que nous apprenons sur l’histoire fijienne qui nous intéresse dans le film de Menanteau mais la manière dont le cinéaste en herbe nous la dévoile, se mettant souvent en scène de façon presque comique avec ce second degré de l’ironie voltairienne, qui nous renvoie à tous ces documentaires télévisuels où il est de rigueur de se prendre très au sérieux, le micro aux lèvres face caméra, avec un ton dramatique empreint de la morgue de « ceux qui savent ».
Olivier Menanteau, lui, travaille au second degré, et son film est un pur produit équilibriste de l’amateurisme dans ce qu’il a de plus noble : l’amoureux de l’art et du regard sur le monde qui l’entoure. Ici pas d’équipe de tournage : un homme seul, livré à lui même et à ses réflexions, à sa sensibilité, qui abandonne la caméra à ses propres cadrages, qui sont tels que parfois le présentateur opérateur a même la tête coupée hors du cadre et que le son est off, comme provenant de son torse, créant une fois de plus un décalage, un recul chez le spectateur qui, loin d’en être gêné, est au contraire poussé à l’éveil. La distance par rapport au sujet est ce qui marque ses images de leur sceau. Parfois le visage de l’auteur est comme juché ; tout petit à la limite du bas du cadre, il parle, mais notre attention est rivée sur cette étrangeté.
Ou bien encore l’image saute, comme si le pied sur lequel était juché l’appareil était bousculé par un autre pied, de chair cette fois-ci, maladroit, au moment où il nous montre les habitants de la ville avec le melting pot culturel, Fijiens d’origine noirs métissés, Indiens et Chinois constituant les deux communautés principales. Parfois la luminosité s’emballe et l’exposition passe de la surexposition à la sous-exposition, et loin de nous irriter, ces effets, dont on se demande s’ils sont vraiment voulus, nous saisissent et renforcent notre intérêt.
C’est comme si Menanteau se mettait à la place de jeunes artistes débutants cinéastes à qui il voudrait transmettre le sens de l’image dans le reportage. Mais ce film ne dérive jamais dans les chemins du reportage, et en cela exemple même du cinéma vérité dans la lignée de Jean Rouch, il présente des situations brutes, telles quelles, jamais mises en scène, spontanées, et la plupart du temps sans les accompagner, les sous ou sur-ligner de commentaires à prétention anthropologique.
Le film s’achève sur une surprenante scène de mise en place d’une exposition, les habitants chez lesquels le réalisateur logeait décidant avant son départ de transformer, sous ses conseils avisés, leur habitation en musée d’art contemporain. Et la dérision qu’on ne peut s’empêcher de ressentir cohabite heureusement avec un élan de sympathie pour ces apprentis galeristes. Un peintre très connu est interviewé et nous révèle les secrets de sa création, qui résident dans la volonté de retrouver les archétypes visuels de sa communauté, en restant un sujet dépendant de sa communauté, de sa famille ou de sa tribu. II insiste sur le fait qu’un artiste ne peut s’individualiser qu’en dernier ressort, avec l’invention d’un nouveau style, ce qu’il a fait et qui lui a permis une reconnaissance dans les galeries et manifestations à Londres et dans les pays anglophones.
Il règne alors dans la description du vernissage qui suit un esprit bon enfant, très touchant où l’on voit même l’auteur quitter sa caméra et venir dans le cadre pour déguster un breuvage exotique. Comme dans tous les événements artistiques du monde entier, le directeur des lieux présente ses artistes, qui sont tous habillés avec une chemise « Bula » verte, indiquant bien leur volonté communautaire.
Tout cela, au corps défendant des protagonistes de l’exposition, devient une métaphore du travail de l’artiste européen qui débarque dans d’anciennes colonies, devenues libres pour leur apporter la lumière de l’expérience économique et artistique. C’est là où Menanteau s’en moque. Tous ces acteurs dont lui-même, relèvent et participent de son fait d’une critique d’un post-colonialisme culturel, où pourtant les créateurs locaux revendiquent et affirment leur autonomie, tout en reconduisant les stéréotypes du monde de l’art européen.
Gilles Verneret
Vu à
Bleu du Ciel, Centre de photographie contemporaine
12, rue des Fantasques
69001 Lyon
Du 23 novembre 2018 au 16 février 2019
Pour voir la vidéo The Fiji Times, https://vimeo.com/311984297