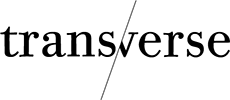Cacophonie et Tuer le temps, 2003, performances
Cacophonie et Tuer le temps sont deux performances proposées par Djamel Kokene-Dorléans lors du projet européen intitulé La Toison d’or, un périple en Mer Noire et Méditerranée, reliant la Roumanie, la Bulgarie, la Grèce et la France, à bord du navire militaire roumain, le Constanta. Ce projet de croisade artistique, organisé par Apollonia pour la France, a eu lieu en 2003. Plus de deux cent personnes embarquèrent pour un périple dans les mers intérieures : artistes, organisateurs, cinéastes, partenaires. Dans chaque port où le Constanta faisait escale, avaient lieu des performances, et des projections en plein air. Les deux performances de Djamel Kokene-Dorléans ont été mises en œuvre dans chacun des pays accostés par le navire. Djamel Kokene-Dorléans a mis en place un processus artistique récurrent consistant en l’enchaînement des deux performances inédites Ces deux actions ont été mises en œuvre à l’arrivée dans chacun des pays et dans des circonstances évoluant en fonction des moyens fournis par les organisateurs de l’événement. Le projet de l’artiste est né du protocole international qui considère qu’un bateau militaire est un territoire. En période d’opérations militaires, à chaque escale l’hymne national retentit sur le pont du navire, puis une fanfare du pays accueillant vient jouer son propre hymne.
Cacophonie consistait pour l’artiste à reprendre cette règle martiale tout en la personnifiant par sa propre identité, car Djamel Kokene-Dorléans a la double nationalité algérienne et française. Il projeta donc de diriger un orchestre qui jouait en simultané les hymnes nationaux de ses deux pays d’ « origine », puis à chaque étape du voyage, d’ajouter à cette suite sonore un nouvel hymne, celui du pays accosté par le Constanta. C’était pour l’artiste une façon de se réapproprier, tout en les détournant, les symboliques et les fonctions même si faire sonner en même temps ces hymnes revenait à créer une dissonance globale. Ainsi était affichée et célébrée une identité en quelque sorte augmentée, si on la compare à celle à laquelle est supposée se rattacher toute identité individuelle. Dans les faits, la performance aboutit à jouer jusqu’à cinq hymnes en même temps. Le dispositif de l’orchestre fut vite abandonné, et les sons furent diffusés par un technicien situé dans le bateau, Djamel Kokene-Dorléans conduisant cet orchestre cacophonique et invisible à partir de la terre ferme.
La deuxième performance Tuer le temps était dans un premier temps une invitation à venir « admirer » (en plein jour) un feu d’artifice sur le pont du navire militaire (étaient conviés aussi bien les membres de l’équipage que le public extérieur). Annoncé par une communication sonore et visuelle, l’événement devait avoir lieu chaque jour à midi et le soir venu, mais dans les faits il n’eut lieu qu’une fois. Dans un second temps, en soirée, était proposée une promenade touristique, dans un quartier de la ville du pays accosté, pour voir les bars de prostitution situés à proximité avec l'artiste en guide-accompagnateur. Le texte suivant de Jean-Claude Moineau a été publié dans le catalogue de cette manifestation.
***
LE CONCERT DES NATIONS À L’ÈRE DE LA GLOBALISATION
Quand s’élève l’hymne national —quand même c’est l’hymne d’une autre nation— tout le monde est supposé se lever. Comme il est des musiques à danser l’hymne national est en quelque sorte une musique à se figer. « Écouter comme » un hymne national —pour reprendre la terminologie de Wittgenstein— c’est se dresser comme un seul homme —l’hymne national s’écoute non pas tant individuellement que collectivement— et se figer dans une attitude respectueuse (comme les putains).
Quoi de plus consensuel et donc de plus kitsch que l’hymne national ? L’hymne national, en dépit de son élévation affichée, n’est pas de la grande musique s’adressant à un public averti pas davantage que de la muzak ou de la variété. Ni musique savante ni musique populaire ni culture de masse mais kitsch (même s’il est toujours possible de faire sécession par rapport au consensus comme l’ont fait les athlètes noirs américains aux Jeux Olympiques de Mexico en 1968 en levant le poing, ce qui procédait d’une sorte de surenchère par rapport à l’acte commun —qui n’en était pas moins « respecté » — consistant à se lever).
Et ainsi y a-t-il réappropriation ici non de l’art s’autoproclamant authentique ou de la culture populaire, pas même de la culture mass médiatique, mais de ce qui, plutôt que de relever de telle ou telle sphère bien délimitée de légitimation, fait consensus non pas dans tel ou tel micro-groupe mais bien dans l’espace national tout entier, de ce qui est tenu pour cimenter l’identité nationale (et quoi également de plus consensuel et donc de plus kitsch que l’identité nationale ?). Mais comment s’approprier ce qui appartient déjà à tout le monde, propriété qui, loin de se trouver remise en cause par l’actuel procès de globalisation, se trouve encore amplifiée par lui, tant au niveau national —la montée des identarismes— qu’au niveau international —la constitution d’un présumé « patrimoine de l’humanité »— ?
En faisant, précisément, dissensus, ou en faisant apparaître le dissensus. Au lieu que, comme dans les cérémonies officielles à caractère unanimiste (du moins en façade), les hymnes propres aux différents États-nations soient joués successivement (dans l’ordre protocolaire ou dans l’ordre d’arrivée des champions), ils ne sont ici pas même sciemment mixés mais simplement joués simultanément, produisant non pas la consonance mais la dissonance. Non pas mise en commun du type « tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil » des différentes « cultures » nationales, mais mise en évidence de l’absence d’accord. Non pas sécrétion d’une identité globale pas davantage que résurgence des identités nationales mais dislocation des identités prédéfinies. Non pas fusion ni même métissage (quel qu’ait été, historiquement, le pouvoir de résistance de celui-ci à l’âge de la colonisation) mais confusion. Identité confuse, paradoxale, identité sans identité, post-identitaire, qui est celle, à l’âge de la globalisation, des migrants de toutes sortes et de leur descendance, écartelés qu’ils sont entre plusieurs identités.
Et art non pas du partage du gâteau par des artistes réputés « internationaux » mais d’un artiste lui-même partagé entre différentes identités.
*****
Encore la musique, dans l’Antiquité, n’était-elle pas découpée selon l’opposition entre musique noble et musique populaire sans pour autant faire consensus mais était-elle tenue en bloc pour l’apanage des lupanars et autres bordels. Ou tout au plus opposait-on non pas la musique populaire à la musique savante mais la pratique musicale sans distinction, la musique destinée à être écoutée, attribuée donc aux prostitués de l’un et de l’autre sexe, à la théorie musicale, à la musique élevée au rang d’art libéral en tant que science des proportions. Loin de faire consensus, la musique était alors considérée comme plus basse que basse.
Et, aujourd’hui encore, si l’on oppose désormais habituellement le divertissement —l’entertainment américain— aux choses et aux plaisirs de l’art (encore que de nombreux artistes, à commencer par les artistes Fluxus, aient rejeté une telle distinction), tout ce qui relève du divertissement n’est pas pour autant divertissement de masse. Au-dessous de la culture de masse, il est encore une subculture, à la fois prisée et méprisée, celle des bars à putes et des boîtes plus ou moins équivoques, se situant à l’incertaine frontière entre légalité et milieu.
D’où la proposition de Djamel Kokene consistant cette fois à « entraîner » les membres du public habituel de l’art qui se fait dans le « bas-fond » de cette subculture, à leur faire pratiquer —charnellement et photographiquement— une forme de tourisme sexuel, non dans le but de chercher à résoudre le litige entre les deux parties mais au contraire, là encore, en vue d’exacerber le différend, quand bien même le différend peut traverser chacun individuellement. Tout comme, dans les faits, à l’encontre du credo moderniste, loin que le grand art se nourrisse exclusivement de lui-même, l’art s’est toujours régénéré non seulement au contact de la culture populaire ou de la culture de masse mais en se frottant à la dite subculture, en s’encanaillant, telle l’Olympia de Manet qui résultait déjà du mélange détonant de la grande tradition de la peinture mythologique (la Vénus d’Urbin du Titien copiée par Manet à Florence dans sa jeunesse) et de la pornographie la plus crue (du moins pour l’époque). Tout comme, aujourd’hui, Philip-Lorca diCorcia, dans sa série Hollywood, et Santiago Sierra, chacun à sa façon, osant l’éthiquement incorrect à une époque qui entend prôner le retour tous azimuts à l’éthique (quand bien même il s’agit d’une éthique molle et c’est pour mieux dissimuler le manque de perspective politique, d’où le caractère fétichiste de ce regain éthique qui ne s’en avère pas moins des plus calamiteux pour l’art qu’il menace des foudres renouvelées de la censure), donnent à voir que le traditionnel recours en art à un modèle —professionnel ou non— a toujours équivalu à recourir aux « services » d’un ou d’une « professionnel(le) ».
Jean-Claude Moineau
Le Concert des nations à l'ère de la globalisation, Texte publié dans La Toison d’or, catalogue d’exposition, Ed° Apollonia. 2005
Vu à
Apollonia (France)
Croisière en Roumanie, Bulgarie, Grèce, France
juin 2003