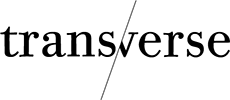24 heures de la vie d’une femme ordinaire (série). Le quotidien. Le raccord. 1974 Tirage gélatino-argentique 50x40. © Michel Journiac / ADAGP. Collection, Maison Européenne de la Photographie, Paris. La série complète 24 heures de la vie d’une femme ordinaire comporte trois parties. Le quotidien : le réveil, le ménage, la lessive, l'arrivée au travail, le pointage, le travail, le raccord, le repas de midi, le café, la cigarette, le départ au travail, la sortie du travail , le métro, les courses, l'achat, la cuisine, l'arrivée du mari, le repas du mari,la vaisselle, le coucher. Le rêve : l'attente de l'amant, l'amant. Les fantasmes : la dame en blanc, la maternité, la putain, l'allaitement, la lesbienne, le viol, le play-boy, la cartomancienne, la cover-girl, femme travestie en homme, la strip-teaseuse,l'enlèvement (1et 2), la reine, la communiante, la mariée, la veuve
MICHEL JOURNIAC L’IMITATION DE LA VIE ORDINAIRE
24 heures dans la vie d’une femme ordinaire marque un moment décisif dans l’histoire de l’art, dont le devenir est encore à ce jour particulièrement insu. Dans cette œuvre exemplaire se condense de manière étonnante tout ce dont l’art, entendu comme capacité d’action et d’interrogation sur le donné, corporel, imaginaire et social, peut être investi ; en même temps que s’expose consciemment une forme nouvelle et radicale d’expression, qui n’a rien à envier aux formules antérieures. Pour tenter d’approcher les enjeux historiques de cette œuvre, qui s’offre à la manière simple et directe d’un « roman-photo » mural et livresque, il faut d’abord tenter de la décrire. Présentées en 44 tableaux photographiques noir et blanc de petit format (50x40cm), marouflés sur bois, en 1974 à la Galerie Stadler, à Paris ; ou sous forme de volume broché in-4 (21x29,7cm) de 48 images, avec dossier biographique de l’artiste, aux Editions Arthur Hubschmid, les 24 heures dans la vie d’une femme ordinaire sont d’abord l’interprétation fidèle des résultats d’un sondage effectué dans la presse féminine de l’époque portant sur les moments les plus importants de la journée vécus par les femmes, ainsi que sur leurs fantasmes dominants. Reprenant l’ordre des séquences de vie et de désir ainsi dégagées par ce sondage, l’artiste a endossé le rôle de la femme ordinaire, et les a exécutées en travesti, dans des décors réels avec des acteurs. Ces derniers (le mari, le jeune vendeur, l’amant, le play-boy, le bébé, le violeur, la lesbienne, etc.), quant à eux, ne sont pas travestis et répondent à une distribution réaliste du genre « roman-photo ». Les images respectent la séparation tranchée des deux catégories du sondage : la catégorie de la « réalité » et celle des « phantasmes », les scènes de la première se jouant sur un fond de décor, les projections de la seconde étant détourées sur fond blanc. Dans les deux catégories figurent des phases à une seule image (« le réveil du mari », « la lessive », « la télévision »), et d’autres à plusieurs images (« le lit », « l’attente », « la séductrice »), ces dernières donnant lieu à des variantes dont la justification ne paraît pas seulement statistique, mais semble relever d’une volonté artistique assumée de répétition interne d’une phase pour elle-même, visant à délier la scansion mécanique des séquences et le rapport univoque du lisible à l’image. Ces petites répétitions dans l’illustration, résultant sans aucun doute d’une grande abondance de prises de vue, ne sont peut-être pas à prendre à la légère, car elles ménagent dans la succession des tableaux arrêtés de l’œuvre, de ces sortes d’accès où l’artiste et son corps donnent à voir un peu plus que l’exécution d’une partition extérieure et toute faite : ce sont comme des moments d’hystérie personnelle dans un continuum de soumission travestie.
Le travestissement de l’artiste en femme ordinaire, clé de voûte des 24 heures, est en fait une opération complexe qui ne laisse pas indemnes les termes qu’elle met en jeu. Le fait pour un artiste de se mettre en scène sous forme travestie dans son travail n’est évidemment pas nouveau en 1974. Depuis Marcel Duchamp et son double féminin Rrose Sélavy, le geste a connu une extension plastique notable, dans la mesure même où socialement le travesti acquérait une puissance d’effraction et de provocation plus grande, sortant du domaine intime des perversions publiquement dénigrées, et servant tout juste de repoussoir comique à la fixation identitaire machiste, pour devenir véritablement un « personnage social », une figure à part maudite entière du monde d’exclusion que nous vivons aujourd’hui. Dans les années soixante et soixante-dix, le travesti prend dans la contre-culture, surtout grâce à la musique pop, une consistance qui fascine, et nombreux sont les artistes à s’emparer de cette figure d’idole sexuelle, parce qu’en elle justement la fascination est tout entière fabriquée et ne résiste pas à la nature — même s’il y a des mecs canons derrière le fard —, et que la grande question plastique à cette époque est celle de la production d’altérité perceptive et non plus la reproduction de la nature perçue. Ce que Roland Barthes résumait fort bien à ce sujet : « Les travestis sont des chasseurs de vérité (...) Le vêtement n’exprime pas la personne mais la constitue. »
Quand Journiac s’empare de la figure du travesti pour les 24 heures, c’est après avoir lui-même identifié dans son travail cette figure simultanée de passeur social d’identification et d’altérité, et l’avoir élargie dans une perspective radicale de déconstruction de sa propre personne sociale et de sa fonction sociologique d’artiste. Ainsi, dans l’Hommage à Freud de 1972, l’artiste se présentait en portrait photographique, travesti une fois en son père et une fois en sa mère, avec ces légendes : « Michel Journiac travesti en Robert Journiac » et « Michel Journiac travesti en Renée Journiac »; tandis qu’à ses côtés une photographie de son père et une autre de sa mère portaient les légendes suivantes : « Robert Journiac travesti en Robert Journiac » et « Renée Journiac travestie en Renée Journiac ». Comme on le voit au travers de cette pièce d’un humour analytique dévastateur, le travesti n’est pas, pour lui, quelqu’un qui déguise son sexe pour arriver en quelque sorte à jouir solitairement d’une altérité simulée ; mais c’est avant tout un geste sociologique qui révèle la négation sociale du corps sous l’emprise du vêtement et des codes comportementaux qui maintiennent la séparation des sexes et des générations. Se travestir ce n’est pas changer de sexe, fût-ce illusoirement — et la question du transsexuel est à cet égard tout autre —, c’est donner à la question du sexe une visibilité manifeste que recouvre et occulte un travestissement normatif général. Et la force de ce très déplacé Hommage à Freud réside en effet surtout dans le consentement des parents à assumer leur propre exhibition travestie, au même titre que celui qui les imite, un consentement auto-parodique des parents qui exhausse le geste artistique aux accents de potache à la dimension dramatique d’un constat historique et critique sur la famille humaine dans la deuxième moitié du XXème siècle. Car, au fond, que l’individu mâle se travestisse en son père (modèle normatif) ou en sa mère (modèle déviant), cela n’entame guère la règle d’identification qui dans les deux cas est sauve : le sujet ne fait qu’intégrer finalement le schéma familial classique de la formation par assomption du modèle parental ; mais que le père et la mère manifestent simultanément leur propre soumission travestie à un rôle d’identités de projection et d’imitation, voilà qui sort le fait du travestissement de la simple revendication existentielle individuelle, pour l’engager sur les rails d’un questionnement radical de la personne humaine et de son corps, et l’établir au niveau d’un fait sociologique primordial qui concerne la société tout entière.
Le travesti pour Journiac n’est donc pas une petite affaire de narcissisme personnel, encore moins d’obsession érotique, ou d’esthétisme provocateur : dans l’économie des outils et des attributs artistiques de son œuvre, Journiac n’emploie jamais que des éléments qu’il a préalablement nettoyés, « lessivés » de tous leurs soupçons névrotiques obsessionnels, comme de tous leurs empâtements romantiques et pseudo-utopiques, pour les rendre à leur pouvoir d’objection formelle et de négation anthropologique. Le travesti, et ceci est une des découvertes de l’œuvre de Journiac, n’est pas uniquement une expression esthétique personnelle, une forme célibataire ou spécifique d’objet de séduction auto-référente ; c’est au plus fort de son objectivation une forme manifeste de l’ambiguïté sociologique et de l’objection dialectique du corps comme viande consciente d’elle-même, susceptible de renverser les conditionnements de la représentation sexuelle, familiale, artistique ou politique. Ce processus d’objectivation du travesti dans l’œuvre de Journiac fut amorcé largement par la série photographique et l’exposition intitulée Piège pour un travesti (Galerie Stadler, 1972), où étaient présentés en comparution photographique linéaire : le corps socialisé du « sujet » travesti (cadre supérieur, voyou, ou autre), son corps dénudé, sa projection travestie dans une idole du cinéma (Arletty, Greta Garbo, etc.), et un panneau miroir. Dans cette pièce, le corps nu marquait d’un suspens indéterminé les deux travestissements symétriques, donnant à choisir au voyeur intégré à l’ensemble par le miroir, laquelle de ses « objectivations », la masculine, la féminine, et ce qu’il faut alors se résoudre à appeler la « corporelle » (lieu de rencontre chiasmatique des deux virtualités sexuelles), conditionne ou nie le désir de l’autre.
Dans un texte rédigé très peu de temps avant les 24 heures, Journiac indiquait avec une netteté sans discussion les enjeux et les visées de son travail, tout en annonçant clairement cette œuvre qui découle logiquement des prémisses établies dans les propositions antérieures. Sous le titre « L’objet du corps et le corps de l’objet », publié dans le numéro 6/8 d’Artitudes (et remanié ensuite dans le livre des 24 heures), il s’agit d’un de ces rares textes d’artiste où s’affirme la pensée de l’art d’une époque, dont la pertinence et la vigueur, au- delà des termes aujourd’hui passés de mode, demeurent intactes. De ce texte, j’extrais ce fragment particulièrement révélateur :
« Le corps réifié, objet conscience se contestant lui-même, aliénation se refusant dans le surgissement du NON, permet la révolte au niveau de la création, dans une tentative pour prendre au piège la réalité sociologique sous tous ses aspects : de la Lessive à la Messe, du stand plus ou moins commercial à la Guillotine ou au travesti, de l’activité politique au mot ; d’établir — puisque toute société, pour exercer sa fonction et lier l’individu dans sa chair, est créatrice de rites (rites où elle tente d’annuler la négation, que pourtant dans son ambiguïté fondamentale elle seule rend possible) — une activité créatrice qui serait nécessairement critique, parodique, et peut se préciser comme une critique rituelle de l’ambiguïté sociologique, dans une formulation volontairement emphatique et dérisoire. Tentative qui, délaissant toute recherche esthétique en tant qu’instrument d’aliénation et produit de consommation, se présente comme une approche événementielle d’une réalité-révolte, à travers le constat critique d’un fait sociologique, créant un lieu de disjonction où le fait lui-même tente de nier sa symbolique sociale. »
Les 24 heures se présentent ainsi, au premier chef, comme un tel « constat critique d’un fait sociologique, créant un lieu de disjonction où le fait lui-même tente de nier sa symbolique sociale ». Il est remarquable à cet égard que Journiac, après des faits sociologiques aussi éloignés dans l’échelle culturelle de la symbolique sociale que, par exemple, la messe et la lessive, la guillotine et le travesti, se soit emparé de ce fait sociologique particulièrement ambigu qu’est un sondage d’opinion. Depuis la fin des années soixante, le sondage d’opinion a connu un développement vertigineux qui l’a fait passer du stade politique d’instrument de légitimation du pouvoir, à celui d’agent conditionneur de normes sociales, répondant parfaitement aux conditions économiques de la société de consommation. Le sondage, loin d’être un révélateur d’opinion, est un subtil modélisateur de conscience qui, sous le couvert de donner la parole à une population, du reste échantillonnée, vise à produire en fait une image- écran, pacifiée par la statistique, de ses rapports de force internes. Aux modèles oppositionnels figés et déjà largement faisandés des partis traditionnels dans les années soixante, les années soixante-dix voient peu à peu se substituer un modèle plus souple d’intériorisation de la société de masse par une batterie de stratégies participatives et relationnelles, qui impliquent une réponse modulée du citoyen à sa soumission, et dont le sondage est la plus ludique. C’est le triomphe du « tout- sondable » et rien n’échappe à la frénésie de l’enquête d’opinion : de la marque de lessive à la messe en latin, de la peine de mort à la liberté sexuelle... Sonder, classer, représenter, normaliser : les 24 heures épousent le moule dominant de leur époque, comme s’il s’agissait pour Journiac de faire l’expérience de la création in vivo de l’imaginaire social de la « vie ordinaire », tel qu’il est fabriqué in vitro par les instituts de sondage. Comme s’il s’agissait pour lui de faire accoucher dans son corps même le réalisme idéologique que cette fabrication sous-tend. Avec lui, naît un « réalisme corporel » qui n’a pas d’équivalent à l’époque, où le corps, comme donné premier de la création, provoque par sa présence parodique d’incarnation les représentations sociales à se disjoindre en elles-mêmes, à se désigner d’elles- mêmes comme masque et travestissement, et enfin à se nier dans l’apparent triomphe de leur manifestation. En un sens, Journiac, sans avoir jamais prêché la vulgate situ, peut être considéré comme le premier grand artiste du détournement, compris comme désappropriation d’éléments sociaux préfabriqués en vue de leur dépassement dans une création supérieure, et même de l’ « ultra-détournement », tel que les situationnistes l’avaient théoriquement annoncé dans leur Mode d’emploi du détournement de mai 1956, comme « un stade parodique-sérieux où l’accumulation d’éléments détournés, loin de vouloir susciter l’indignation ou le rire en se référant à la notion d’une œuvre originale, mais marquant au contraire notre indifférence pour un original vidé de sens et oublié, s’emploierait à rendre un certain sublime. »
Oui, on peut dire que les 24 heures dans la vie d’une femme ordinaire s’emploient à rendre ce certain sublime, ou ce sublime certain, qu’est la vie d’une femme ordinaire détournée par un travesti du commun. Et, en somme, avec les 24 heures, n’est-ce pas le travesti qui devient sublimement « ordinaire », tandis que le modèle fabriqué par sondage de la femme ordinaire se révèle quant à lui ordinairement sublime, voire scabreusement incertain, fictif ou mythologique, résultat d’une pure projection idolâtre (semblable en cela aux stars du cinéma du Piège pour un travesti), et n’étant finalement vivable que dans la parodie outrancière d’une incarnation négative dont le maquillage s’affiche et se dénonce simultanément ?
L’un des coups de force symbolique de cette œuvre réside ainsi dans le double niveau d'incarnation du modèle féminin : pétrifié dans la succession des postures (le raccord, les courses, le ménage...) que le sondage lui reconnaît en propre, il n’en est pas moins idéalisé par le travesti, qui projette les 24 heures de sa vie ordinaire asservie au modèle dans un document humain d’un « parodique-sérieux » sobre et désarmant, finalement indifférent à l’original féminin, escamoté une première fois comme vie singulière par le sondage et vidé une seconde fois de son sens normatif par le travesti.
Vie et mort d’une femme ordinaire à l’âge du sondage et du travesti.
Avant de conclure cette petite introduction aux 24 heures, il convient de dire également quelques mots (mais une étude entière devrait y être consacrée, et ce n’est ni le lieu ni l’heure) au sujet de ces images photographiques, et de la référence à cette forme réaliste et populaire de narration qu’est le roman-photo. Si Journiac a toujours considéré la photographie dans son usage le plus courant comme relevant d’une pratique laïque de l’icône, on peut tout à fait voir dans ces 24 heures, en même temps qu’une approche documentaire d’un genre narratif standardisé et réservé à un lectorat féminin le plus souvent prolétarisé, une véritable tentative pour convertir de l’intérieur les moments préférés d’une représentation aliénée en étapes d’une imitation ici et maintenant de la Passion. Bien sûr, le travesti imitant la femme ordinaire n’est pas le croyant sur les pas du Christ, bien que l’imitation de celui-ci ne soit pas exempte de cette exhibition hystérisée qui marque celui-là, et que le travesti porte bien une croix au moins aussi lourde, celle de faire croire à son modèle. Mais les 24 heures sont loin d’être des Exercices spirituels comme ceux d’Ignace de Loyola, et encore moins une Introduction à la vie dévote chère à François de Sales. C’est dans le chemin même de la « vie ordinaire », entre « réalité » et « phantasmes » que les 24 heures inaugurent une nouvelle voie de passage à l’image et de passion d’incarnation pour l’art de notre temps.
Il reste sans doute encore beaucoup à apprendre de cette œuvre aussi profonde et truffée de pièges dialectiques à déclenchements retardés (ils n’attendent que des voyeurs plus nombreux pour sauter !), qu’elle est simple, directe, et d’une sérénité jubilatoire sans égal.
Vincent Labaume
Texte publié le 13 février 2001 par la Galerie, Noisy-le-Sec, à propos de l'exposition Journiac/24 h de la vie d'une femme ordinaire présentée par Hélène Chouteau du 06.03 au 06.04.01
Vu à
Exposition Michel Journiac, L'action photographique
20.04.17 - 18.06.17
Maison européenne de la Photographie
5/7 Rue de Fourcy, 75004 Paris
Site de l'artiste