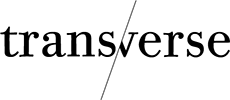Installation composée d’une vidéo réalisée avec Lo Bell / Gabrielle, de 6 photographies et d’une conversation entre Frédéric Nauczyciel et la sociologue Nacira Guénif-Souilamas, qu'ils ont eue après avoir traversé ensemble Baltimore en compagnie de Lo Bell / Gabrielle.
Le projet Hard Skin a débuté par l'attribution d'une allocation de recherche du Programme Hors les Murs/Institut Français. Frédéric Nauczyciel a ainsi découvert la ville de Baltimore, et rencontré la communauté des « vogueurs ». Il entame avec eux un travail consistant à traverser le territoire en mode performance. Cette « résidence-traversée » aboutit à un ensemble d'oeuvres : installations, photographies, vidéos, performances, qu'on a pu découvrir en particulier au Mac/VAL (2012), au Centre Pompidou et à l’Ecole d’Art de Besançon (2013), à New York (2014), en Seine-Saint-Denis avec la MC93 de Bobigny (2015/2016), puis au Musée d’Art et D’histoire de Saint-Denis et au 104 (2017). Cette conversation avec la sociologue Nacira Guénif-Souilamas explicite la démarche de l'artiste.
Nacira Guénif-Souilamas : Tes photographies, ou vidéos deviennent un lieu de passage, un lieu d'émotions, et puis, au-delà, un lieu de trouble. Elles font évoluer les représentations, voire les transforment. Il s’en dégage un étonnement par rapport à ce qu'on prétend cartographier et ce dont on prétend rendre compte. À ce titre, tes comptes-rendus sont singuliers. Dans ces désajustements, il y a une capacité à montrer la réalité qui enfin se donne à voir, surgit. Durant les décennies passées en France, ce surgissement a été perdu, alors que par ton approche pour la résidence de Baltimore, HardSkin, tu ouvres une brèche. C'est que l'existence des personnes excède largement ton propos, quelque chose échappe dans la prise de vue, mais convoque, requiert le spectateur. Il y a une sorte d'extension de la photographie, d’extériorité de sa mise en scène. La difficulté est justement de parvenir à rendre compte de ce qui n'est pas dans la photographie et qui conditionne l'existence de la photographie, à commencer par l'existence des personnes.
Frédéric Nauczyciel : En effet, chacune de mes productions photographiques est liée à un territoire. Les lieux sont contenus dans la façon dont les personnes les habitent. Ce qui m’intéresse, ce sont les lignes de partage qui séparent des territoires symboliques et la relation intime de mes protagonistes avec ces territoires.
NGS : Alors, c'est la question d’habiter qui pose la distinction entre frontière et ligne de partage. Une frontière serait un lieu, un espace, en tout cas une ligne infranchissable. Alors qu'une ligne de partage précisément, c'est une ligne qui peut faire partage. Elle ne sépare pas seulement, elle peut aussi relier soit des territoires, soit des personnes, soit des groupes. A quelle condition une frontière est-elle, en fait, une ligne de partage, une ligne à partir de laquelle, même si les versants sont opposés, ils participent bien l'un de l'autre ? L’expression « ligne de partage » est en soi un paradoxe. C'est sans doute sur ce paradoxe qu'il faut jouer ; car cela participe d'un même mouvement, et obéit à un même objectif technique. En réalité, les villes sont à la fois séparées et partagées. Et ces lignes sont des frontières symboliques, des conventions que l’on transgresse. Traverser ou ne pas traverser requiert un choix. Tu montres bien dans ta façon de pérégriner dans Baltimore la manière dont les espaces sont investis : même si s’impose l'image d'une ville où certains espaces sont inaccessibles, la réalité est tout autre.
FrN : Je suis allé à Baltimore sur les traces d’Omar, le personnage de la série télévisée culte « The Wire » [« Sur écoute »], un homme du ghetto noir, qui vole la drogue aux dealers. Omar définit sa justice selon son propre code de l’honneur et en refusant les codes de la société ou des gangs, il acquiert une forme d’invincibilité. Ce personnage a réellement existé à Baltimore, à ceci près que David Simon et Ed Burns, auteurs de la série, en font un homme homosexuel. Omar redéfinit les conventions et les frontières symboliques. Il crée sa propre géographie dans la ville qu’elle soit physique, urbaine ou mentale ; sa propre géographie des comportements. Il ne se tient jamais là où on l’attend et l’on ne sait littéralement jamais par quelle rue il va arriver. En refusant les assignations, il cesse de se fondre dans la norme établie sensée protéger et dans le même temps, contrôler. Sa posture, selon moi politique, répond aux nouvelles réalités urbaines ; une forme nouvelle de dissimulation active qui m'évoque le fait qu’il doit exister, aux Etats-Unis comme en Europe, des gens qui cherchent à se redéfinir et redéfinir les territoires qu’ils habitent. Posture proche de ce qu’on appelle la Banjee Realness : le fait de performer, l’attitude du ghetto de certains noirs et latinos américains homosexuels qui refusent la visibilité contrainte. C’est un double mouvement, à la fois de dissimulation et d’affirmation de leur culture d’appartenance. Je reconnais dans le personnage d’Omar la Banjee Realness réinventée, popularisée, sortie de l’underground. Sur les traces d'Omar, je rencontre la communauté des vogueurs. Le voguing est cette danse performative des communautés homosexuelles et transgenres noires américaines des ghettos, de Harlem d'abord, puis de toutes les villes noires comme Atlanta, Baltimore, Washington et maintenant de la côte ouest. Une danse qui retourne les signes du pouvoir blanc en s'appropriant les poses des mannequins en couverture du magazine Vogue. Née dans les années 60 et performée dans les prisons comme dans les quartiers noirs, popularisée par Madonna dans les années 1990, le voguing a fait récemment son apparition sur la scène artistique de New York où l’art afro-américain devient pleinement partie prenante de l’art contemporain. J’arrive à Baltimore pour me rendre compte qu'il existe une Ballroom scene (ainsi que l’on dénomme la communauté du voguing) extrêmement puissante, active, qui n'a plus rien à voir avec la scène médiatisée de New York. Une scène plus real, plus authentique. La ballroom scene est un microcosme de jeunes gens qui ne performent pas devant un public, mais qui performent pour eux-mêmes face à leurs pairs. Les défis qu’ils se lancent ont pour but d’apprendre à être le meilleur. Le fait de défier l'autre est une manière de se dépasser soi-même. C’est un apprentissage initiatique qui permet de se tenir debout dans la société américaine, qui pousse à être de plus en plus soi-même, à se débarrasser de ses incertitudes tout en n’étant jamais figé dans ses certitudes. Si être au plus près de soi-même c'est être une femme, alors c’est envisager les conséquences que cela peut avoir. On ne s'arrête pas au seuil de la transsexualité. Quand ils ne sont pas en train de performer, flamboyants, costumés, les vogueurs de Baltimore sont Omar. Plus précisément, c’est la somme, la réunion de chacun d'entre eux qui compose Omar, figure symbolique, emblématique, iconique et moderne de la masculinité en milieu urbain. La Banjee Realness fait partie des ramifications et des évolutions du voguing sous l’influence des nouvelles cultures urbaines, du Hip Hop, du RnB. Après les années 1980, le voguing est retourné dans l’underground pour ressortir hybridé, vivifié, réinventé. En insufflant une torsion dans l’écriture du personnage d’Omar, Simon et Burns ont mis à jour des situations extrêmes et pourtant réelles dont on feint d’ignorer l’existence. Choix scénaristique d’autant plus remarquable qu’Omar est devenu le personnage le plus populaire de la série, comme si cette Banjee Realness résonnait aujourd’hui pour tous. J'avais eu l'intuition en regardant « The Wire » que Baltimore agissait comme une métaphore des enclaves périphériques. Cette posture politique de l’anti visibilité, cette manière organique en perpétuel mouvement d’habiter le monde, m’intéresse artistiquement.
NGS : D’une certaine manière, la question n'est pas celle de la périphérie versus le centre. C'est celle d'un milieu hostile dans lequel il faut pouvoir exister et s'en donner les moyens. Est-ce que l’on transporte le milieu hostile avec soi ou pas ? N'est-il pas généré par la personne elle-même ? En particulier dans les expériences trans/genres : quel que soit l'endroit où la personne se trouve, elle suscite une forme d'hostilité, manifeste une volonté de faire face, exprime une puissance d’agir à travers une performance qui inévitablement produit le milieu hostile contre lequel ou avec lequel elle va exister. Tout contre lequel elle existe, en fait, parce qu'elle a aussi besoin de cette sorte de confrontation. Dans un tel contexte, tu éprouves les limites. Et, cette mise à l'épreuve est aussi performative dans la manière de s’habiller, de choisir son accoutrement, sa posture, sa manière de se déplacer. Cette recherche extrême est une sophistication au fondement même de ce mode d'existence. Le milieu hostile est un espace à pénétrer pour en recomposer les différentes dimensions. Voilà ce que parviennent à faire les vogueurs. Ils éprouvent les limites et les repoussent.
FrN : C'est ce que dit Dale Blackheart, le vogueur de Baltimore avec lequel je travaille le plus étroitement : « Connais-toi toi-même, c'est ce que je fais, c'est la vie de ghetto ». Dans sa flamboyance, dans son expérience trans/genre de la féminité dans le milieu hostile que constitue Baltimore, comme Omar, il redéfinit, dépasse ou porte avec lui l'hostilité pour que les frontières se déplacent. Il s’y rend visible ou invisible, il est en capacité d’y apparaître ou d’y disparaître à l’envi.
NGS : Les vogueurs ont conscience des enjeux, des limites, des pressions et, en même temps, des ressources dont ils disposent précisément pour entreprendre ce régime d'existence. Il y a aussi une certaine mobilité sexuelle et de genre qui est à l'œuvre. Pour outrepasser le régime de visibilité contrainte la condition préalable à cette manière d'exister est de prendre conscience de l'ensemble des formes de limitations. Ces personnes en ont acquis une intelligence précise, aigüe, peut-être même exacerbée, alors qu'elles dépendent, souvent à leurs dépens, des espaces dans lesquels elles évoluent et de l'ensemble des limitations qui leur sont imposées. A partir de cela elles inventent leur alchimie. Mais il serait illusoire d'imaginer qu'elles viennent à bout des limites existantes. Elles ne les dissolvent pas, elles les transgressent, les dépassent, les reconfigurent. Comprenant que les limites n'ont pas vocation à disparaître elles parviennent à en jouer, non pas à exister avec, mais à s'inventer, littéralement, pour les transformer. Etre capable de surmonter l'ensemble des obstacles, des contraintes, y compris des violences qu'elles exercent est une épreuve physique et sociale quotidienne. Il y a une âpreté de ce mode d'existence qui est proportionnelle à ses contraintes et explique l'extrême inventivité et la nécessité de mobiliser de multiples ressources, de formes de soi qui vont très au-delà de ce que font les personnes qui ne sont pas marginalisées, qui ne sont pas en butte à cette hostilité. Dans leur manière d’investir la ville, les vogueurs définissent des territoires incertains dont les frontières, pourtant, sont tangibles.
FrN : En effet, j'ai décidé d’interroger ce qui pour moi constitue la puissance du voguing : sa capacité d'invention à l'intérieur de frontières, de contraintes, de limites très fortes. Sa capacité à se vivifier, à se réinventer me ramène à la définition d’un dispositif en art contemporain, capable de faire création tout en se renouvelant sans cesse. Les catégories du voguing déploient toutes les variations entre l’extrême masculin et l’extrême féminin. C'est une manière d'apprendre à faire des choix dans la vie, des choix qui sont parfois définitifs. Les règles du voguing sont très fortes ; elles sont codifiées à l’extrême puisqu’elles doivent prendre en compte une variation infinie de situations et d’expressions du genre. Chaque situation nouvelle, chaque expression nouvelle de soi enrichit et complexifie les règles et les catégories de la communauté. Tout l’enjeu est de déplacer ces règles, voire de les rompre, les transgresser pour faire surgir une chose à laquelle personne n'avait pensé – dans son personnage, son alter ego, ou dans sa performance, dans sa bravoure, dans ce qu’on appelle la fierceness - la férocité – un vogueur va devenir légendaire. Il fait avancer la communauté toute entière et en repousse les frontières. Être légendaire c’est, dans le même temps, exister aux yeux de la communauté et à ses propres yeux. En existant à ses propres yeux, paradoxe merveilleux, il n'a plus rien à prouver et il peut devenir ce qu’il veut, où il veut, quand il veut. Il peut dépasser les limites de la communauté, aller dans le monde. Ce qui est aussi très beau dans le fait d'être légendaire, c'est que lui seul le sait. L’une des attitudes d'être légendaire, c'est de ne jamais le dire, de ne jamais s'en vanter, puisque, de toute façon, on est légendaire. C’est, à mon sens, le degré ultime de la performativité.
NGS : C’est une forme de souveraineté. C’est cela qui se joue notamment dans un contexte territorial qui fait, qu'en se métamorphosant, ces personnages métamorphosent aussi le territoire dans lequel ils se trouvent, y compris ces espaces sans qualité, détruits. En fait, ces espaces-là sont nécessaires à l'invention de personnages aussi flamboyants, aussi souverains. Et, à leur manière, ils donnent à voir et à vivre ces espaces-là différemment. Les vogueurs donnent à voir la codification des manières d'être visible : visiblement pas à sa place ou visiblement à sa place. La même personne peut ressentir l’une ou l’autre expérience. Ces personnages ont conscience d'être visiblement à leur place dans certaines situations, et pas dans d’autres. Comme s’ils incarnaient la frontière qui marque le passage de l’une à l’autre. La ligne de partage parcourt alors la surface de la peau, est à fleur de peau, dans l’apparence et l’accoutrement queer (étrange, dérangeant), entre genre et race, ainsi donnés à voir. Alors pourquoi "HardSkin" ? Reprenons le récit : nous devons cette expression, à un des personnages que tu côtoies. Une personne habitant Baltimore qui entretient un double mouvement dans sa manière d'exister : Lo Bell, alias Gabrielle. Nous avons parcouru Baltimore ensemble. Lors de ce périple j’ai été saisie par la relation très intime qu’il entretient avec ces espaces, avec ces lieux. Et son intimité consiste précisément à leur conférer un autre sens que celui qu'on leur attribue usuellement. Il les requalifie, il les recompose, il les réinvente, il les métamorphose. Et on se surprend après coup à poser sur ces lieux un autre regard. Ce n’est pas juste une expérience esthétique. Il/elle y introduit une charge, une forme, quelque chose qui serait de l'ordre d'un possible qu'on serait bien en mal d'y trouver si on s'y égarait par hasard, ou par erreur. Autre chose commence à être insufflée dans ces lieux dès lors qu'ils sont investis par ces personnages.
FrN : C’est à mon sens le cas du portrait de Gabrielle dans Park Heights, l’un des quartiers les plus abandonnés de Baltimore. Deux mois après avoir réalisé un portrait de la famille Revlon, je rencontre Lo Bell, incapable de reconnaître en lui Gabrielle, son alter ego. Nous décidons de photographier Gabrielle. Je lui demande de filmer toute la préparation préalable avec son téléphone. Je filme la transformation. Je mets ainsi en place un processus qui tend vers cette image, afin qu’il/elle soit dans une conscience pleine de ce qui est en jeu. Lo Bell vit chez sa grand-mère, dans le sous-sol de la maison. Il y a un accord tacite, un non-dit dans la famille : on connaît l’existence de Gabrielle, mais elle doit se dérober aux regards. Nous quittons ainsi la maison par l’arrière cour, pour nous rendre dans Park Heights, un décor à l’abandon de maisons vides et éventrées. Je n’ai jamais eu peur dans Baltimore parce qu’il y avait une évidence à ma présence, mue par la nécessité du travail. A Park Heights, j’étais inquiet. Je pense qu'il y avait un défi, une revanche de la part de Lo Bell à vouloir performer Gabrielle pour moi dans cet environnement. A la fois une forme d'insolence et de virulence ; et une manière, en me faisant faire l’expérience de Park Heights, de m’amener au plus près de sa propre expérience intime de cette ville et de ce quartier. Ce qu’elle résume sur le moment par quelques mots : « tu es plus en sûreté ici que dans ma famille ».
NGS : La suite fut aussi inattendue, lors de notre rencontre à Baltimore. Lo Bell monte dans la voiture qui devient le lieu mouvant de la conversation. Elle traverse la ville et en même temps la conversation se déroule ; elle se déroule dans ce qui n’est plus un décor. Comme si la ville était le cadre nécessaire à ce qui se dit dans la voiture. Ce n’est pas fortuit. Il y a une relation étroite, intime entre les deux. Et, dans la minute qui suit, Lo Bell me tend son téléphone portable sur lequel il fait défiler des photographies. Il me dit en montrant une des photographies avec sa perruque blonde : « je suis elle ». Comme s‘il se présentait à moi : « je me présente à toi, je te présente moi ». Ce moi est multiple puisqu'il est à la fois la personne qui est à l'arrière de la voiture et la personne qui pose en perruque blonde sur l’écran du téléphone. Deux personnes à la fois distinctes et communes, qui sont nécessaires l'une à l'autre. Et celle dans la voiture m'explique comment celle qui est sur la photo existe et à quelles conditions elle existe. Très vite dans l'entretien, il/elle dit : « tout ça c'est une affaire de Hard Skin », de peau dure ; c'est une affaire d'endurcissement ou de cuir dur. Ce n’est pas que la peau soit dure, c'est plutôt avoir le cuir résistant.
FrN : Et plastique, c'est à dire extrêmement solide, qui puisse résister sans casser. Sans se blesser ; sans être blessé.
NGS : Exister en étant cette personne avec qui je parle jusqu'au personnage qu'elle s'invente. Il faut, effectivement, avoir beaucoup de plasticité et beaucoup de résistance.
FrN : Il tire sa force du fait d’être totalement Gabrielle lorsqu’il est dans le bus à six heures du matin alors qu’il rentre d'une boîte de nuit - et non pas Lo Bell en Gabrielle, ce qui lui amènerait une forme de fragilité face au regard des autres. Il dit, quand il parle de Hard Skin : « Je suis dans le bus, je n’ai pas le choix et je vois bien les regards des gens. J’ai deux possibilités : soit avoir peur, soit apprendre à ouvrir mon sac, à me remaquiller, à remettre mes cheveux en place et à être Gabrielle. ». A partir du moment où il fait le choix d'être Gabrielle dans le bus, elle transforme le regard des autres passagers. Elle transforme le monde.
Ce texte a été commissionné par la DATAR (Délégation Interministérielle à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale, service du Premier ministre) en 2014.
Voir le texte d'Anne-Marie Morice à propos de l'installation vidéo multi-écrans La Peau vive exposée au Musée d'art et d'histoire de Saint-Denis en 2017.
Site de l'artiste
Références
-
« The Wire », série télévisée en cinq saisons de David Simon et Ed Burns, HBO, 2002/2008
-
« The Wire : reconstitution collective », ouvrage collectif sous la direction d’Emmanuel Burdeau, 182p, 2011 (éditions Prairies ordinaires)
-
« Baltimore » de David Simon, 936p, 2012 (éditions Sonatine)
-
« Strike a pose : histoire(s) du Voguing » de Tiphaine Bressin et Jérémy Patinier, 267p, 2012 (éditions Des Ailes sur un Tracteur)
-
« Pier Queen », poésie, d’Emanuel Xavier, 45p, 1997 (éditions Pier Queen Productions)
-
« Paris is Burning », documentaire de Jennie Levingstone, 78 minutes, 1990
-
« The Fire Flies, Francesca, Baltimore », film de Frédéric Nauczyciel, 42 minutes, 2013
Vu à
ISBA, Institut Supérieur des Beaux Arts, de Besançon, 2013