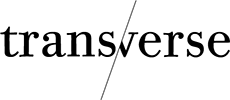Photographies, tirages barytés noir et blanc contrecollés sur aluminium, poliptypques, 1999. Installation en 2019 dans le Prieuré Sainte-Gaubruche, Saint-Cyr-La-Rosière, dans le cadre du parcours organisé par Le Champs des Impossibles.
Les Frères Christille, photographes Dauphinois, ont laissé un de ces dépôts photographiques dont l’historien, le sociologue et l’ethnologue découvrent aujourd’hui l’intérêt documentaire. La photo de classe se développe à la fin du XIXe siècle, comme pratique institutionnelle : chaque école de ville, village et bourg, tous les ans, commande une image des enfants scolarisés. Cette photo constitue un genre, elle appartient à la mémoire populaire, elle fait surgir de l’oubli, de la poussière, une beauté brute, une écriture à peine déchiffrée de notre histoire, privée et collective. Photo sans qualité, sans intention artistique, elle transmet une image de soi qui rejoint l’album privé de la famille, et cependant nous rattache au grand corps social. Cette image de corps enfantins, définis par leur parenté de classe, témoigne de la plus haute volonté démocratique, l’enseignement populaire.
Pour qu’ils tiennent dans le cadre, le rituel a figé maîtres et enfants en un étagement, les a alignés et superposés, selon le protocole de l’agencement raisonné des tailles et des âges, en un bâti de corps serrés, cimentés, mur vertical des corps dressé contre celui de l’école dont on entrevoit quelquefois une fenêtre, et une fois, derrière la vitre, visage de sévère songerie dominant la scène, un maître fantomatique, et nous vivrons avec les ombres, avec les fantômes.
Car cette addition d’identités – visages, physionomies, airs de famille disséminés, est devenue collection anonyme, assemblage étrange de devenirs, de promesses d’existence, de destins mystérieux dont ces petits êtres, dans leur arrangement sage et domestiqué, sont les témoins sentinelles, ombres graves au garde-à-vous, fascinées par ce qui les regarde en face : leur image à venir, inscrite au fond de la chambre noire du photographe. Existences, que nous conjuguons au passé antérieur, déjà promises, par la loi du déterminisme social, au travail des fermes et des bourgs, aux maternités nombreuses ou célibats mélancoliques, aux hasards et extravagances romanesques de toute vie. Mais surtout à la vie serve, mais surtout à la guerre, classes prochaines des tranchées et tombeaux de 14-18. Voilà qu’un instructeur militaire entraîne les tout petits jeunes gens aux fusils de bois…
Et nous scrutons passionnément ces corps enfantins, ce qu’ils portent de leur histoire, sarraux ceinturés, vestes trop courtes et bas tirés, galoches malmenées, cols haut boutonnés, chignons tirés des filles qui bombent excessivement le front, dénudent le regard. Mains multiples, froissées, abandonnées, jointes ou nouées. Regards éberlués d’effroi, de solennité, regards de défi ou d’interrogation, regards dissidents, le plus souvent dardés vers le point focal qui les rassemble, les unit et les agrège en une éternité petite, celle de leur enfance, fugitive et silencieuse – car l’infans est celui qui n’a pas la parole. Pas le langage, pas la voix. Pourtant ces images muettes, qui font si peu de bruit au fond de nos tiroirs, bruissent d’une rumeur en nous, elles parlent de ce que nous fûmes alors, dans l’apprentissage primitif de nos corps, sensations neuves, étrangeté à soi dans la découverte d’odeurs de craie, d’éponge rance, de planchers lessivés et d’encre violette versée dans la porcelaine des encriers, odeurs des poêles, des cours d’automne, des laines mouillées, salive, larmes et sang des écorchures, corps à corps sauvages des récréations, ennui et sommeil des soirs de classe, et aussi premiers cris entendus dans la foule des autres, première voix chantonnante des récitations et leçons ânonnées… Ce doit être là que j’ai appris l’écriture, la lecture, dit Catherine Poncin, là mes premières ratures…, dans ce soudain sentiment de ce qui nous reconnaît, nous identifie à nous-même. Nous avons été ces cors d’enfance, de dissemblance et de ressemblance, ils nous appartiennent.
Le travail qu’entreprend Catherine Poncin réincarne ces corps oubliés, leur rend visage propre, voix et parole, restitue leur langage vivant. Elle travaille au corps le corps noir de l’image, le corps mort des embaumements photographiques. Elle extrait du corps multiple la singularité discrète; de l’identité collective le signe individué; de l’histoire commune l’histoire du sujet. Photographiant la photo, elle soumet celle-ci au regard d’amour, d’inquiétude qui restaure le lien. Son regard accommode, réajuste la distance, recadre, fragmente et agrandit, réinvente l’espace du dedans. Il désigne et percute le secret, invisible à force d’être exposé : là où une buée de lumière perdait le visage, où une ombre mangeait le regard, là où une face noyée dans l’indifférenciation du groupe s’effaçait, comme on s’efface dans la vie, humblement, mortellement, devant ce qui vous dépasse et vous oppresse. Restauration sans révérence nostalgique ni pathos. Il y aurait de quoi, pourtant. Son regard restaure la dignité, la considération, rehausse de noblesse ces visages sans qualité, sans nom, sans mémoire, qui sont notre histoire populaire.
En un grand mur noir, c’est la photo imaginaire d’une classe qui n’a jamais existé, qui désincruste et réassemble en tableau les visages, agrandis comme ils ne l’ont jamais été, exposant leur énigme à notre regard. Et puis, en grands diptyques ou triptyques, le relevé de thèmes graphiques. Ainsi celui du boutonnage qui dénonce à la fois la discipline vestimentaire du corps contraint, et l’insolite liberté du motif courant comme un signe, une écriture palimpseste de photo en photo, instruisant notre lecture nouvelle de l’image. Et cette frise terrible, dansante et convulsive, pacifiée ou tourmentée de ce qui nous résume, notre humanité manuelle, portraits de mains comme autant de visages. Enfin la colonne lumineuse où nous regardons en négatif les plaques, et qui condense tout le travail artistique de Catherine Poncin : aller voir de l’autre côté, non derrière la photo, mais son envers. C’est-à-dire sa nature même de photographie, car la plaque, la pellicule s’emparent d’abord de l’envers du monde, de l’invisible du réel. Par la photo de la photo, Catherine Poncin met en abyme notre mémoire visuelle, nous apprend à traverser avec elle l’apparence photographique. Elle émeut en nous un savoir obscur sur cet imaginaire du corps et sur la vérité que nous y cherchons, elle nous rend à l’intelligence de la photographie et de son histoire.
Anne-Marie Garat
Texte écrit pour l’exposition, à la suite d'une commande, au Musée dauphinois de Grenoble, mars 1999
Vu à
Le Champ des Impossibles
du 27 avril au 2 juin 2019
Prieuré Sainte Gaubruche Eco Musée du Perche, Saint Cyr la Rosière